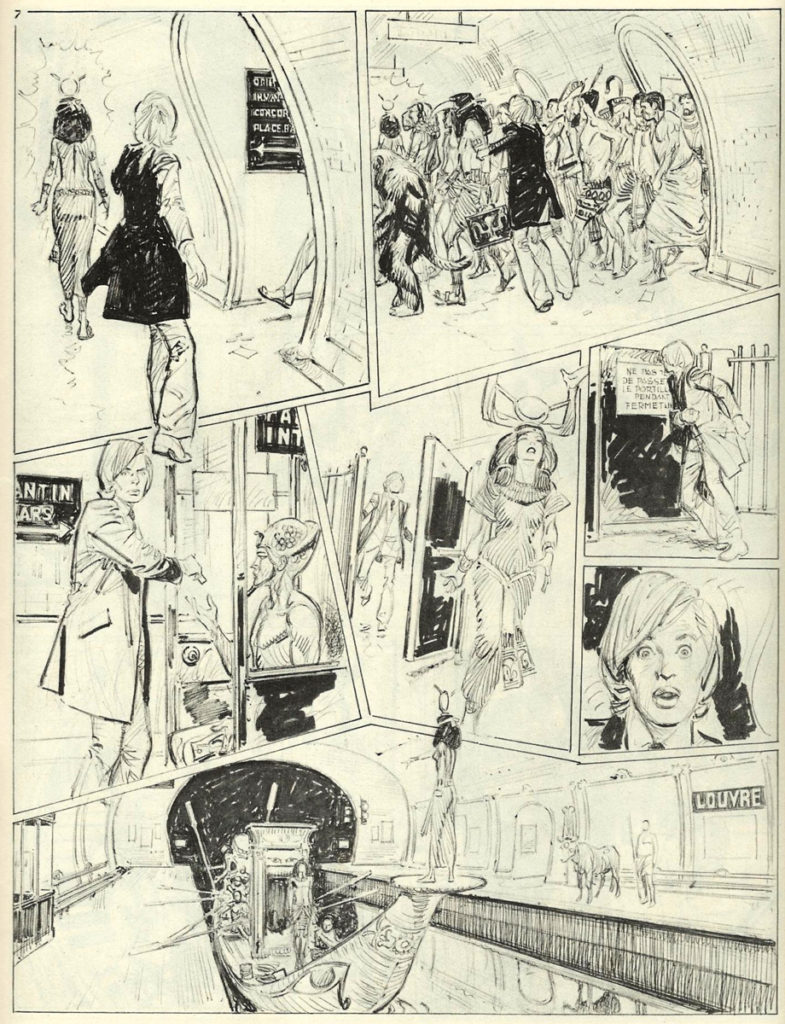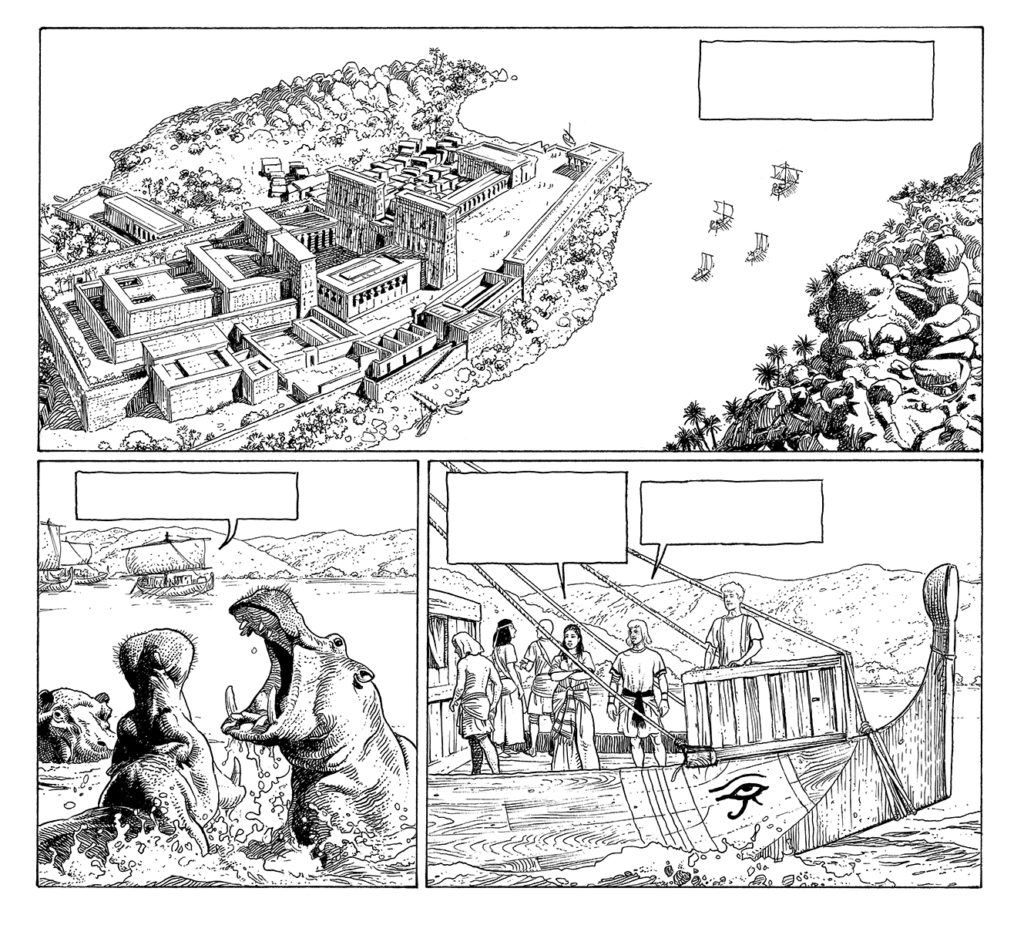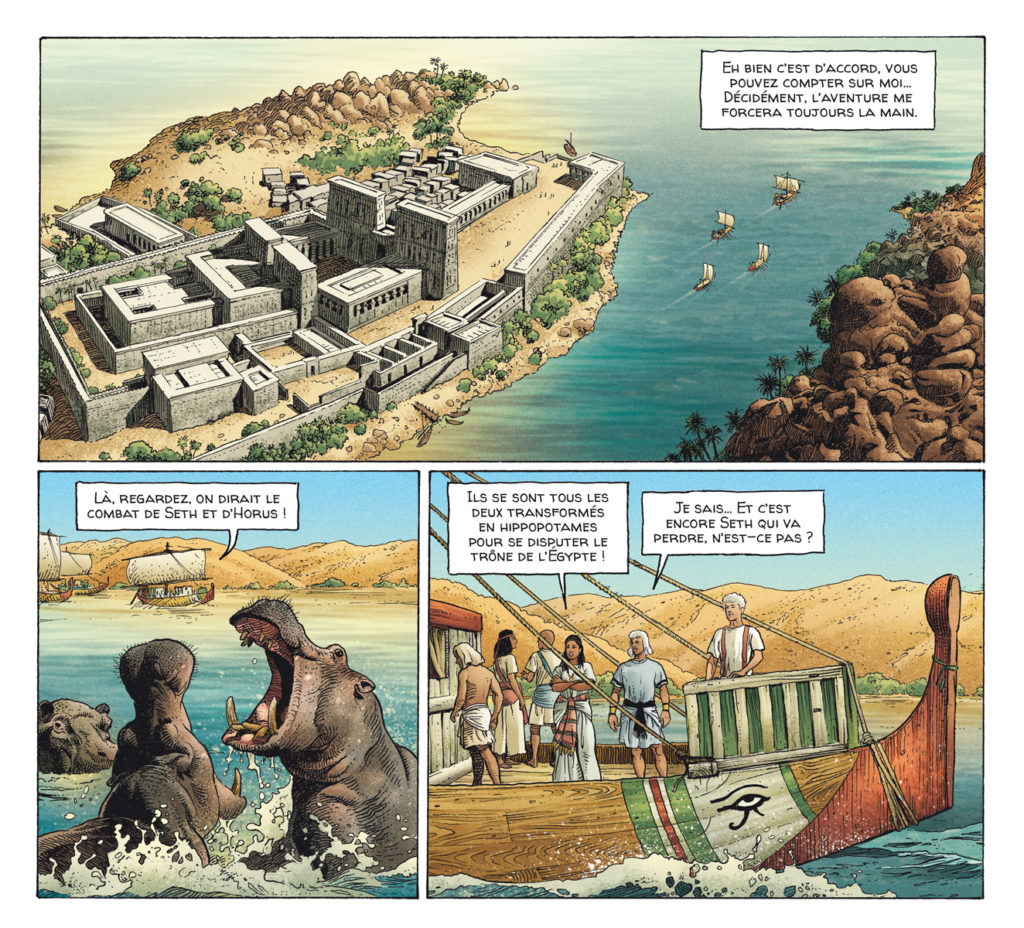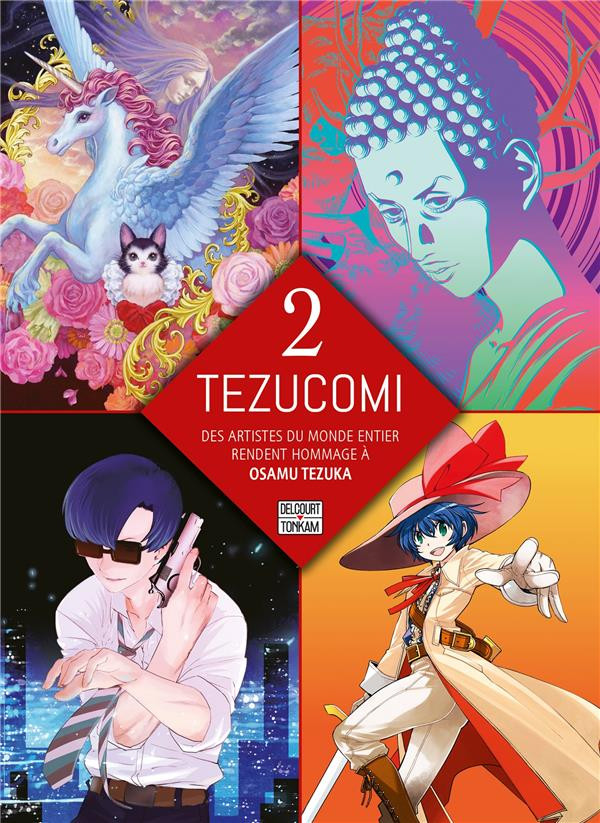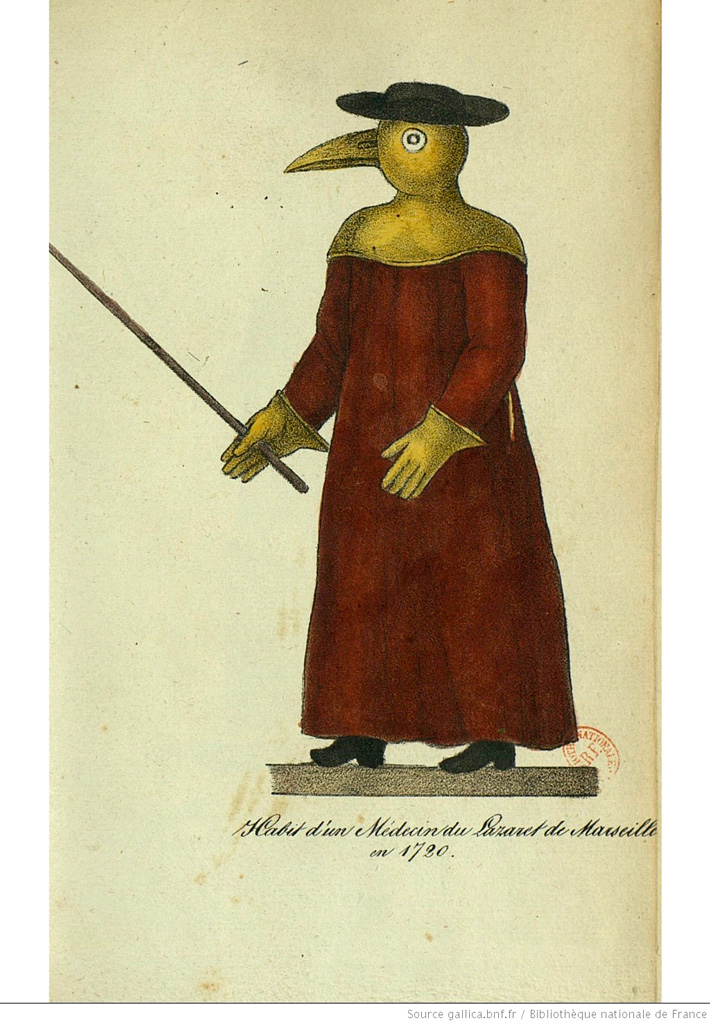Comme c’est la fête de la musique et que je suis de bonne humeur, j’ai envie de vous raconter une histoire horrible aujourd’hui. Comme elle était d’abord destinée à FB, je ne l’ai pas illustrée par l’image qu’elle mériterait mais par ce sympathique playmobil du dieu Apollon. Il a l’air gentil comme ça, mais c’est le psychopathe de l’histoire.
 Elle ne commence pas avec lui mais avec Marsyas, un satyre de Phrygie, en Asie Mineure (Turquie actuelle) ou plutôt avec Athéna, la déesse grecque de la sagesse. Un jour, elle inventa l’aulos, une sorte de double flute, mais voyant comme elle lui déformait les joues, elle la jeta au loin, déçue.
Elle ne commence pas avec lui mais avec Marsyas, un satyre de Phrygie, en Asie Mineure (Turquie actuelle) ou plutôt avec Athéna, la déesse grecque de la sagesse. Un jour, elle inventa l’aulos, une sorte de double flute, mais voyant comme elle lui déformait les joues, elle la jeta au loin, déçue.
Marsyas ramassa l’instrument et se mit à en jouer. Il subjugua tous ceux qu’il croisa et bientôt sa réputation de musicien se répandit partout. On commença même à dire qu’il jouait mieux qu’Apollon, le dieu de la musique, lui-même. Marsyas, flatté, laissa dire.
Apollon finit par entendre parler de son rival, et furieux, le défia devant le roi Midas et les Muses. Le vainqueur pourrait faire ce qu’il voudrait du vaincu. Trop sûr de lui, Marsyas accepta.
Midas le désigna comme vainqueur mais les Muses, les divinités des arts, choisirent bien sûr Apollon. Le dieu dota Midas d’oreilles d’âne (!) et condamna Marsyas à… être écorché vif (!) afin que nul après lui n’ose se prétendre meilleur qu’une divinité. La sentence fut exécutée sans pitié et Apollon fit ensuite tanner et transformer en outre la peau du malheureux Marsyas.
Dans l’Antiquité, les touristes pouvaient encore frissonner d’horreur devant elle dans une grotte de Phrygie.