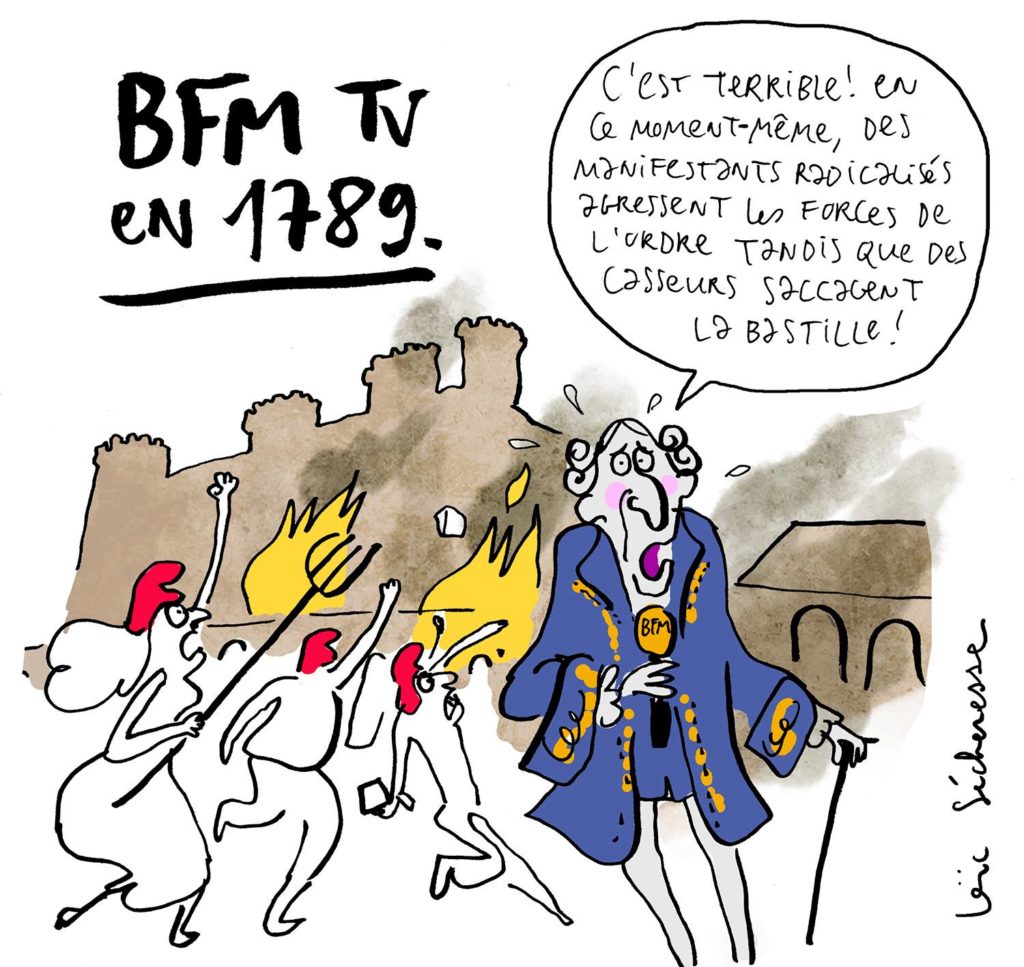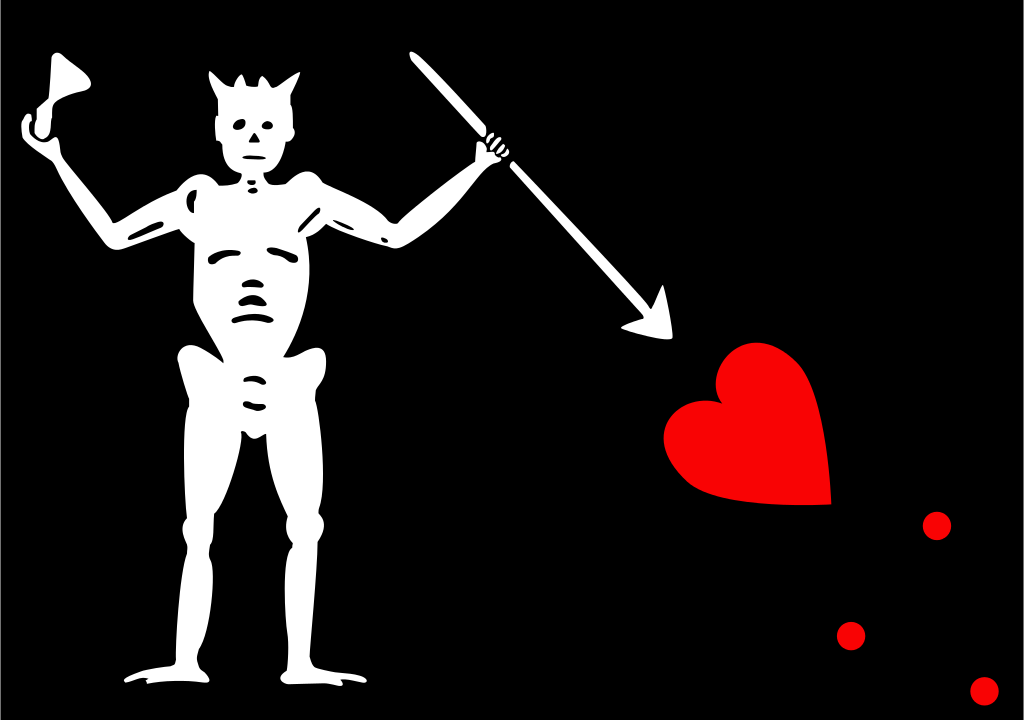Tel est le titre de l’amusant tableau ci-dessous, peint par un anonyme vers 1594 et conservé au Louvre. Il est donc censé représenter à gauche, Julienne d’Estrées, duchesse de Villars et à droite sa sœur, la belle Gabrielle. Elles ont encore 5 autres sœurs et sont toutes de mœurs si légères que madame de Sévigné les surnommera « les 7 péchés capitaux ».
Gabrielle, d’abord maîtresse d’un ancien mignon d’Henri III, devient en 1590 celle du roi Henri IV (l’homme représenté à l’arrière-plan, un tissu rouge sur le sexe ?). Il la couvre de cadeaux comme le château royal de Montceaux-lès-Meaux ou le titre de duchesse de Beaufort. Mais Gabrielle a de plus hautes ambitions : elle veut devenir reine, épouser le roi, ce que symbolise peut-être la bague qu’elle tient de la main gauche.
Quoi qu’il en soit, séparé de la reine Margot depuis de longues années, Henri envisage très sérieusement de se remarier avec sa favorite. Le 23 février 1599, il le proclame même officiellement et lui offre l’anneau porté lors de son sacre.
Gabrielle est alors très impopulaire tant auprès du peuple qui la surnomme « la duchesse d’Ordure » que des nobles très catholiques car elle a soutenu la mise en place de l’Édit de Nantes. Promulgué en 1598, il donne aux protestants des droits tant civils que politiques et religieux et met fin de fait aux guerres de religion qui ensanglantent alors la France depuis 1562.
Mais la « mauvaise réputation » de Gabrielle n’est pas de nature à faire reculer le roi, d’autant qu’elle lui a déjà donné ce qui manque tant à son premier mariage : des enfants ou plutôt des héritiers pour le trône de France. Sur le tableau, le geste de la duchesse de Villars n’est sans doute pas seulement érotique: en pinçant le téton de Gabrielle, elle montre que celle-ci est enceinte ou vient tout juste d’avoir un bébé.
Pourtant, Gabrielle ne sera jamais reine. Enceinte du quatrième enfant d’Henri, elle se met à convulser dans la nuit du 9 au 10 avril 1599. Son visage noircit. Elle a de terribles douleurs au ventre. Elle meurt quelques heures plus tard. Le bruit court très vite qu’elle a été empoisonnée, mais on pense plutôt aujourd’hui qu’elle a été victime d’une éclampsie, une crise convulsive généralisée. Gabrielle est enterrée dans le chœur de l’église de l’abbaye de Maubuisson dirigée par sa sœur Angélique, un autre des 7 péchés capitaux.
Henri, lui, refuse bravement la proposition de la duchesse de Villars de succéder à sa sœur dans son lit. Mais, il se console très vite avec une autre jeune femme, Henriette d’Entragues. Il lui promet aussi le mariage à condition qu’elle accouche d’un fils. Elle ne meurt pas à cette occasion mais… fait une fausse couche. Henri n’a plus qu’à se résoudre à épouser Marie de Médicis, « la grosse banquière » comme la surnomme Henriette. Même si les deux époux ne s’entendront jamais vraiment Marie donnera au roi ce qu’il attendait, en plus d’une dot de 600 000 écus d’or : 6 enfants en 9 ans de mariage.